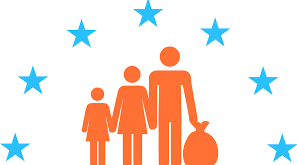La société européenne (SE) constitue un fort symbole de la volonté des États de permettre aux sociétés de l’Union européenne (UE) de réaliser des opérations transfrontalières, en leur octroyant une réelle mobilité en Europe. Toutefois, même si de nombreuses sociétés ont opté pour la SE (LVMH, Allianz, Christian Dior ou encore Airbus – pour ne citer qu’elles), la SE reste un outil marginal. Il convient de comprendre ce semi-échec, en analysant son fonctionnement, avec ses points forts et ses points faibles.
Une genèse difficile
Le droit communautaire des sociétés s’est orienté, au fur et à mesure de sa construction, dans trois directions différentes : tout d’abord, par une harmonisation des droits nationaux, essentiellement par le biais de directives ; puis, en favorisant la concurrence entre les divers droits nationaux des sociétés, solution recherchée par le juge communautaire qui aboutit à favoriser les législations les plus libérales, poussant ainsi à une harmonisation en direction de ces dernières ; enfin, en instituant une société européenne, dite societas europaea, soumise essentiellement au droit de l’UE.
L’origine du projet de société européenne appartient toutefois à la doctrine – et non aux auteurs des traités.
La conception d’origine était d’introduire des statuts uniformes de société anonyme (SA) dans les pays membres, afin de faciliter l’unification des droits en présence. L’objectif était donc de mettre à la disposition des entreprises, un modèle de société transnationale à l’échelle de la communauté européenne, détaché des réglementations des Etats membres et adapté aux besoins d’un marché intérieur intégré.
Néanmoins, si les objectifs étaient louables, leur mise en œuvre s’est avérée quelque peu houleuse. En effet, une fois les débats ayant opposé les tenant de la formule dualiste (conseil de surveillance et directoire) aux partisans du système moniste (président nommé au sein du conseil d’administration) résolus, la principale source de ralentissement dans la mise au point de la SE a été la délicate question de la participation des salariés à la gestion de l’entreprise.
C’est au cours du sommet de Nice du 8 décembre 2000, que les quinze chefs d’États et de gouvernements ont abouti à un accord sur le statut de la société européenne. Un règlement relatif au statut de cette SE a été adopté le 8 octobre 2001[1], puis complété par une directive du même jour concernant l’implication des travailleurs[2].
Concernant le droit français, ces textes ont été transposés en droit interne par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, complétée par un décret d’application du 14 avril 2005.
S’agissant du droit applicable, la société européenne est avant tout soumise à la législation de l’Union, à savoir le règlement n° 2157/2001 – qui, comme tout règlement européen, est d’application directe dans les États membres – et à ses statuts ; la loi nationale, celle du siège social statutaire, ne s’applique qu’à titre subsidiaire. Le droit interne n’a ainsi vocation à s’appliquer seulement en cas de silence dudit règlement ou des statuts, ou encore dans certaines matières relevant de l’ordre public (i.e. dissolution, liquidation et droit des entreprises en difficulté).
Il apparaît que le droit national est subsidiaire par rapport au droit européen. Toutefois, la situation semble, en réalité, bien plus ambiguë.
La société européenne à travers l’Europe
Avant d’analyser son fonctionnement, il importe de rappeler que, même s’il ne s’agit pas de la forme la plus répandue, la société européenne n’en demeure pas moins une réalité pratique. Cette notion juridique, assez exotique en France, connaît à travers l’Europe un succès, sporadique certes, mais certain.
La SE a connu un vif succès en République tchèque (56% des sociétés européennes immatriculées), où celle-ci semble apparaître comme une forme sociale intéressante du fait de sa plus grande souplesse par rapport aux autres structures nationales. Les statistiques concernant la République tchèque ne sont néanmoins pas très représentatives, du fait qu’il existe un certain nom de SE « coquilles », créées dans l’attente d’investisseurs – de nombreuses « coquilles » ayant été activées pour exercer de « petites » activités (dentiste, etc.)[3].
Le second pays à avoir immatriculé le plus grand nombre de sociétés européennes est l’Allemagne, mais ce, pour des raisons différentes. En effet, les sociétés anonymes allemandes ne connaissent que la forme de gouvernance dualiste (i.e. avec un directoire et un conseil de surveillance) : adopter le statut de SE leur permet ainsi d’accéder au mode de gouvernance moniste, ce qui est perçu comme un élément de souplesse, y compris en matière de droits de participation des salariés.
La société européenne a été choisie par toutes les typologies d’entreprises : des grands groupes mondiaux opérant également hors de France (en France par exemple, le groupe VIEL, dont 47% du chiffre d’affaires est réalisé hors de l’espace européen, et seulement 15% en France) ; des sociétés cotées (en France par exemple, UNIBAIL-RODAMCO, SCOR, EUROFINS, SCIENTIFIC, SWORD GROUP) ; des sociétés non cotées, parmi lesquelles des PME et des ETI en recherche de croissance à l’international (à titre d’exemple, PERIMATIC, dont le chiffre d’affaires de 2010 s’est élevé à 3,9 millions d’euros) ; des entreprises familiales (à titre d’exemple, SAPARDIS filiale du groupe PPR, dont le capital est majoritairement détenu par la famille Pinault) ; ou encore, des entreprises au statut réglementé (MUTAVIE ET SCOR par exemple, sociétés soumises à la réglementation du secteur des assurances).
De plus, tous les modes de constitution envisagés par le règlement ont eu l’occasion d’être expérimentés, notamment en France : transformation, fusion transfrontalière, création de « holding SE » ou de « filiale SE » – y compris, une filiale unipersonnelle d’une société européenne préexistante.
À titre de remarque toutefois, la création d’une « holding SE » semble être le mode de création le moins utilisé : cela semble logique, dans la mesure où ce mode de constitution de société est rarement utilisé en pratique, même en dehors du cas spécifique de la société européenne.
La société européenne, une forme familière au formalisme exacerbé
La société européenne, calquée sur le modèle français de la société anonyme, nous est de ce fait familière, tant dans son fonctionnement que dans ses modes de création. Cela devrait la rendre plus attractive, tout du moins en France. Néanmoins, entachée d’un formalisme extrêmement lourd, couplé à de grandes difficultés à lire le droit qui lui est applicable, la SE tend à repousser les praticiens.
Les modes de constitution de la société européenne
La société européenne se constitue sous forme de société anonyme, au capital d’un montant minimum de 120 000 euros, divisé en actions. Il en ressort qu’il s’agit d’une structure juridique réservée aux entreprises de taille relativement importante. Il est de plus impossible de créer une SE ab initio, cette forme sociale étant alors réservée à des personnes morales déjà constituées.
Aux termes de l’article 2 du règlement n° 2157/2001, il existe actuellement quatre modes de constitution d’une société européenne.
- Tout d’abord, par voie de fusion entre deux ou plusieurs SA, constituées selon le droit d’un État membre de l’UE, et ayant leur siège statutaire ainsi que leur administration centrale dans l’Union, sous réserve qu’au moins deux des sociétés concernées relèvent du droit d’États membres différents.
- Ensuite, par le biais de la constitution d’une holding, dite « SE holding », entre sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée (SARL), constituées selon le droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire ainsi que leur administration centrale dans l’UE, sous réserve – encore une fois – qu’au moins deux d’entre elles relèvent du droit d’États membres différents, ou possèdent depuis deux ans minimum une filiale ou une succursale dans un autre État partie à l’Union.
- Il est également possible de créer une société européenne au travers de la constitution d’une filiale, dite « SE filiale », entre sociétés et/ou autres entités juridiques de droit public ou privé (par exemple, avec un établissement public, une association, etc.), constituées selon le droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale au sein de l’UE, à la condition – comme toujours – qu’au minimum deux de ces groupements relèvent du droit d’États membres différents ou possèdent depuis deux ans minimum une filiale ou une succursale dans un autre État partie à l’Union. Il convient par ailleurs de rappeler que, non seulement une SE peut constituer, elle-même, une ou plusieurs filiales sous forme de société européenne, mais également que le législateur français prévoit qu’une telle société peut constituer une SE unipersonnelle[4].
- Enfin, une société européenne peut être créée par transformation, étant précisé que cette possibilité est uniquement offerte aux SA constituées selon le droit d’un État membre et disposant de leur siège statutaire et de leur administration centrale dans le territoire de l’UE, et sous réserve qu’elles possèdent depuis au moins deux ans une filiale relevant du droit d’un État membre.
Il en ressort donc que l’accès à la SE est réservée aux entreprises européennes, en ce sens que seules les sociétés relevant d’un État membre ont la possibilité d’en constituer une. Quelle que soit la modalité choisie pour cette constitution, il faudra que la ou les sociétés initiatrices aient vocation à une activité d’entreprise européenne. Ainsi, le règlement n° 2157/2001 exige-t-il, comme il l’a été vu lors précédemment, qu’il s’agisse de deux sociétés relevant de deux États membres différents (i.e. constitution par fusion ou par création de holdings ou de filiales communes), ou d’une société d’un État membre ayant déjà depuis deux ans, au moins, une filiale dans un autre pays partie à l’UE (i.e. constitution par transformation ou par création de holdings ou de filiales communes) voire même un simple établissement (i.e. constitution par création de holdings ou de filiales communes).
Le fonctionnement de la société européenne
Concernant les organes sociaux, le règlement n° 2157/2001 prévoit le mode d’organisation de la société européenne et décrit minutieusement les pouvoirs et les obligations de chaque organe social. Il ressort clairement que ces règles sont, à peu de choses près, celles qui s’appliquent déjà à la société anonyme de droit français. Les entreprises françaises ne devraient donc pas être dépaysées.
En effet, la SE comporte, d’une part une assemblée générale des actionnaires, et d’autre part un organe de surveillance et un organe de direction, soit un seul organe d’administration, selon que les statuts ont opté pour le système « dualiste » ou le système « moniste ». C’est ainsi que les sociétés européennes disposent du même choix que celui offert par le droit français aux constituants de SA, entre société avec conseil de surveillance et directoire d’une part, et société avec conseil d’administration d’autre part.
La loi française est toutefois venue préciser que, concernant sa direction et son administration, la SE immatriculée en France est régie par les dispositions relatives à la direction et à l’administration des SA, à l’exception des règles de quorum du conseil d’administration et du conseil de surveillance, ainsi que des conditions de délibération du directoire[5]. Les assemblées générales d’actionnaires de la société européenne restent soumises aux règles prescrites aux assemblées d’actionnaires de la société anonyme.
S’agissant des rapports entre les actionnaires, qui ne sont absolument pas envisagés par le règlement, le droit français offre une très grande liberté statutaire[6]. Il est en effet possible de stipuler dans les statuts d’une SE immatriculée en France, qui n’entend pas offrir au public ses actions, des clauses restreignant la libre négociabilité de ces titres : clause d’agrément, clause de sortie conjointe, clause d’inaliénabilité ou de suspension des droits non pécuniaires, voire même d’exclusion. Attention toutefois, cette liberté n’est pas totale : il convient de mettre en œuvre la procédure d’autorisation des conventions réglementées prévues pour les SA[7].
Enfin, concernant le délicat volet de la participation des salariés, il paraît opportun d’expliquer à quels résultats ont aboutis les vifs débats à son sujet.
Afin de faire immatriculer une société européenne, il doit être parvenu à un accord avec le personnel, sur les modalités de sa participation à la gestion des activités de ladite société. La participation des travailleurs peut prendre plusieurs formes : ils peuvent être représentés dans le conseil d’administration, ou être représentés par une autre instance distincte – étant précisé qu’il est néanmoins possible de convenir avec eux d’un autre modèle. Il convient, en outre, de fournir des locaux et un soutien financier aux représentants des employés, afin que ces derniers puissent mener à bien leurs activités.
Toutefois, dans le cas où la SE a été constituée par voie de fusion, il est possible de la faire immatriculer, et ce même si les négociations avec les employés n’ont pas abouti. Ce principe s’appliquera également lorsque le personnel des sociétés fusionnées n’avait aucun droit de participation avant l’opération de fusion.
La société européenne, un outil qui fait peur
La société européenne semble rester un outil marginal dans le paysage français – et plus généralement européen – des sociétés, en raison de l’image d’une société « lourde » et compliquée à mettre en place.
Tout d’abord, c’est le volet social qui effraie. En effet, comme il l’a été étudié précédemment, celui-ci impose aux entreprises de mettre en place un mécanisme d’implication des salariés européens dans la future SE (i.e. la mise en en place de mécanismes d’information des salariés, de consultation, voire de participation au sein des organes de gouvernance). Cette lourdeur, augmentant avec la taille de l’entreprise et son caractère international – et donc pluri-culturel – rebute aujourd’hui bon nombre d’entreprises.
De plus, l’exigence d’avoir une filiale depuis au moins deux ans dans un autre État membre pour pouvoir se transformer en société européenne freine de nombreuses ardeurs d’expansion des sociétés encore au simple stade de projet d’extension passant par le biais de la SE. Enfin et surtout, c’est la complexité du droit applicable à la SE qui semble la pénaliser : les multiples renvois aux différents droits nationaux et le manque d’uniformisation en compliquent la lecture. Dès lors, les entreprises, effrayées par d’éventuels « labyrinthes » juridiques, rejettent l’option de la société européenne, avant même de se plonger dans l’analyse des bénéfices qu’elles pourraient en tirer.
À cela, s’ajoute l’absence d’une uniformisation du régime fiscal, celui-ci apportant son lot de désagréments.
L’absence de régime fiscal, véritable talon d’Achille ?
Tout au long de la difficile gestation de cette nouvelle forme de société, la question du statut fiscal de la SE a été sous-jacente aux débats et travaux. Néanmoins, les nouvelles discussions se focaliseront par la suite essentiellement sur le seul droit social – l’épineuse question de la place des travailleurs dans cette société – et ce, jusqu’à la solution trouvée lors du sommet de Nice de décembre 2000, la question du statut fiscal de la société européenne disparaissant quasiment du débat.
C’est toutefois à tort que la question de l’uniformisation du régime fiscal de la société européenne a été esquivée.
Dans une lettre ouverte aux membres du Parlement européen[8], l’U.N.I.C.E attirait d’ailleurs expressément l’attention des parlementaires sur le volet fiscal du statut de la SE, le considérant comme fondamental pour le succès complet de cette nouvelle forme de société trans-communautaire. Fut notamment proposé dans le cadre de cette lettre, un mécanisme de consolidation du résultat fiscal de la société européenne et des amendements aux directives d’harmonisation actuellement en vigueur, et notamment la directive « fusion ».
Les États membres sont réticents à l’instauration d’un régime fiscal propre à la SE, en raison du fait que le domaine de la fiscalité directe reste, de nos jours, au cœur de la souveraineté fiscale des États. Il est aisément compréhensible qu’ils puissent se montrer quelque peu hésitants et réservés à admettre qu’une toute nouvelle forme de société, justement transnationale, vienne brutalement bouleverser l’état de leur droit en matière fiscale. D’autant plus que la société européenne, une fois dotée d’un statut fiscal communautarisé, risquerait fort de faire concurrence aux formes nationales de sociétés de capitaux, qui elles-mêmes, n’auraient pas conféré les mêmes avantages aux opérateurs économiques.
Ainsi, la segmentation fiscale du Marché unique reste aujourd’hui la règle à laquelle la société européenne n’apporte malheureusement aucune exception.
Société nationale de type communautaire[9], la SE relève, en l’état actuel du droit, du même régime fiscal que n’importe quelle autre entreprise multinationale constituée sous forme de société anonyme.
Elle est donc assujettie aux impôts et taxes des États dans lesquels elle dispose d’une structure. Une exception a toutefois été prévue : les sociétés européennes constituées par le biais d’une fusion peuvent être imposées dans l’État où elles ont leur siège social. Ainsi, leur bénéfice global est imposé dans l’État où se trouve leur leur siège, après compensation entre les pertes subies par ses établissements situé dans un État membre et les profits réalisés par d’autres établissements situés dans d’autres États. Elle est donc simultanément soumise à la législation fiscale de l’État de son siège et du lieu de situation de ses établissements stables.
L’adoption de son statut ne confère finalement aucun avantage par rapport aux autres formes de sociétés que connaissent les États membres. Bien au contraire, la société européenne reste ignorée des directives « mères-filles » , « fusion » et « rassemblement de capitaux », qu’il conviendra d’adapter rapidement, ainsi que le rappelait la Commission elle-même. Plus encore, la SE ne peut, à l’heure actuelle, être utilisée pour réaliser certaines opérations de restructuration, telles que, par exemple, la transformation d’une société en holding par filialisation de ses activités économiques.
Du point de vue du droit français, le strict principe de territorialité, posé par l’article 209-I du Code général des impôts, s’oppose radicalement à toute intégration entre le résultat du siège et celui des divers établissements étrangers de la société, et encore moins de celui de ses filiales. C’est ainsi que, le plus souvent, le résultat fiscal constaté dans des établissements stables étrangers de la société française, SE comprises, est exonéré en France, car exclusivement imposable dans l’État de leur implantation, sous réserve de conventions.
En définitive, sauf à envisager comme le fait la Commission, la mise en place d’un corps de règles unique en matière d’impôt sur les sociétés et la définition d’une assiette consolidée applicable à toutes les activités sur le marché européen, la société européenne, comme ses consœurs, est à ce jour soumise à autant de statuts fiscaux différents qu’il y a d’États membres. Concurrents les uns des autres, les États n’hésitent guère à user de tous les éléments de leur système fiscaux, spécifiques ou structurels, dans le but d’attirer et de garder les investissements et l’activité économiques sur leur territoire nationaux – et non européen !
Le risque semble d’ailleurs réel de voir les États membres user de leur liberté pour se livrer à un dumping fiscal, propre à inciter la SE à s’immatriculer dans leur juridiction. Et c’est ce retour au « chacun pour soi », contraire à l’esprit communautaire et venant de nouveau complexifier le droit applicable à la société européenne, qui apparaît comme son véritable « talon d’Achille », tant sur le plan théorique que pratique de cette société.
Mais au-delà de ces lourdeurs et de cette absence de régime fiscal propre, la société européenne présente un intérêt pratique non négligeable pour les sociétés exerçant leur activité à l’échelle communautaire.
Un véritable intérêt pratique trop souvent négligé
Tout d’abord, le fait de bénéficier de « l’image SE » dans l’accompagnement d’un projet peut être un avantage considérable lorsqu’une entreprise est en quête d’expansion à l’échelle communautaire.
En effet, l’image européenne que véhicule le statut de la société européenne s’avère être un outil opérationnel, afin d’exercer son activité dans l’espace communautaire. Cette image peut notamment être bénéfique pour faciliter les implantations, affirmer l’envergue européenne d’un groupe, ou encore pour en faciliter la gestion – par exemple, dans le cadre d’une réorganisation de la gestion d’activités par ligne de produits ou de type de services, ou de l’accompagnement d’une offre publique d’achat entre sociétés d’États membres différents.
Ensuite, le statut de SE permet de renforcer les partenariats – par le biais de holdings ou de filiales communes – et d’accompagner les grands projets transfrontaliers. Ainsi, en raison de son statut supranational, la société européenne a été perçue comme l’outil approprié dans le cadre du rapprochement entre groupes de nationalité différente, afin d’éviter de froisser la susceptibilité d’un partenaire, ou encore pour accompagner un projet d’envergure européenne.
Enfin, le choix de la SE permet de faire face à un besoin de mobilité, devenu nécessaire du fait de la mondialisation des rapports économiques, par le biais de la possibilité d’un transfert de siège.
Il s’agit là d’un atout majeur du statut de la société européenne. Celle-ci bénéficie de la possibilité de transférer son siège dans n’importe quel État membre de l’espace européen, et ce sans perte de personnalité morale, moyennant une décision de l’assemblée générale extraordinaire. Réaliser une telle opération est beaucoup plus difficile voire impossible pour une société anonyme, notamment cotée, de droit français qui, non seulement devra obtenir une décision unanime de actionnaires pour procéder à un transfert transfrontalier de son siège, mais également pourra se heurter à l’impossibilité de s’immatriculer dans le pays d’accueil sans préalablement s’être radiée de France, ce qui reviendrait à lui faire perdre la personnalité morale.
De nombreux transferts de siège ont ainsi déjà pu être opérés au sein de l’espace européen par des SE. En France, il a été procédé aussi bien à des transferts de siège de sociétés européennes vers la France qu’à des transferts de siège hors de France. Sur les 25 SE immatriculées en France, 8 arrivent de l’étranger : 7 sont en provenance des Pays-Bas (5 SE du groupe FONCIERE LFPI, 2 SE du groupe PIERRE & VACANCES), et une est en provenance du Luxembourg (MAGNISENSE SE). Notons toutefois que ce sont surtout les sociétés cotées qui ont été les premières à s’aventurer dans la procédure de transfert hors de France. Ainsi, à titre d’exemple, EUROFINS SCIENTIFIC SE a réalisé son transfert de siège au Luxembourg le 30 mars 2012.
Concernant la pertinence de la société européenne au regard du droit français, signalons que le statut de celle-ci est plus souple que celui de la SA. Créer une SE présente en effet des avantages liés aux spécificités que le législateur lui a octroyé aux dans son fonctionnement.
Ainsi, une société européenne bénéficie d’une liberté statutaire plus grande que sa sœur française, la société anonyme, et ce sur plusieurs points importants, notamment le fait qu’en assemblée générale, les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote ou s’est abstenu ou a voté blanc ou nul[10]. On voit dans l’application de cette disposition, un avantage spécifique pour faciliter la prise des décisions en assemblée générale.
Le point d’orgue est que les SE françaises non cotées ont la possibilité, comme il l’été précédemment étudié, d’inclure dans leurs statuts des règles d’aménagement des rapports entre actionnaires similaires à celles autorisées dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) telle qu’une clause d’inaliénabilité, une clause d’exclusion, une clause de suspension des droits non pécuniaires ou de sortie d’un actionnaire[11].
Il convient donc de constater qu’une fois le caractère théoriquement complexe de la société européenne surmonté, celle-ci présente un intérêt pratique non négligeable et qui gagnerait à être connu par un plus grand nombre d’entreprises souhaitant se développer et conquérir le marché européen.
Propositions d’améliorations
Seule la société anonyme peut, dans tous les cas, être à l’initiative de la création d’une SE, et ce quelle que soit la voie de constitution utilisée.
L’accès est beaucoup plus réservée pour les autres formes sociales, et notamment pour la SAS qui, en particulier, ne peut se transformer en société européenne. Or, cette société a eu un réel engouement en France et se trouve de ce fait privée de la possibilité d’adopter le statut de SE, sauf transformation préalable en SA. A titre d’illustration, INNOVATIS ET CIE, société en nom collectif (SNC), a dû se transformer en société anonyme pour pouvoir ensuite accéder au statut de SE.
Le règlement apporterait ainsi une souplesse supplémentaire, s’il permettait à d’autres formes sociales que la SA d’accéder au statut de société européenne, notamment par voie de fusion ou par voie de transformation en SE[12]. Le rapprochement du régime des sociétés anonymes de celui des SAS pourrait constituer une autre solution, qui ne dépendrait, dans ce cas, que du législateur français et tendrait aux mêmes résultats d’accessibilité au statut de société européenne.
Ensuite, il serait judicieux de sécuriser la souplesse des clauses régissant les relations entre les actionnaires de la société européenne.
En effet, le législateur français a permis aux SE, ne faisant pas appel public à l’épargne, d’introduire dans leurs statuts, des clauses d’exclusion, d’inaliénabilité ainsi que de changement de contrôle similaires à celles autorisées pour les SAS. Cette possibilité apporte, sans conteste, une souplesse importante et louable pour les relations entre ses actionnaires. Comme le souligne Noëlle Lenoir dans son rapport sur la société européenne, aucune SA non cotée, en France et en Europe, ne peut librement aménager ses statuts – ainsi que peut le faire la société européenne non cotée – les rapports entre ses actionnaires. Dès lors, apparaît une contradiction entre l’application du droit applicable aux sociétés anonymes, réputées pour leur sécurité, et l’éviction d’un des principes fondateurs de cette sécurité.
Il serait ainsi souhaitable que la Commission fasse une proposition de modification du règlement en ce sens, afin d’éviter de voir un jour la Cour de justice de l’Union européenne saisie d’une question préjudicielle sur ce sujet, susceptible de freiner l’utilisation de ces clauses. Le législateur français pourrait également saisir cette opportunité pour modifier le régime juridique de la SA afin de permettre expressément à ces sociétés, d’introduire dans leurs statuts de telles clauses, dont la violation serait sanctionnée par la nullité comme pour les SAS. Ceci permettrait de sécuriser leur utilisation par les SE et, corrélativement, la liberté statutaire qu’elles apporteraient permettrait de compenser avec le formalisme du fonctionnement des SA que nombre d’entreprises fuient désormais, pour se tourner vers la SAS.
En permettant à la société européenne d’être à la fois plus accessible et plus sécurisée, il est indéniable que de plus en plus d’entreprises à échelle communautaire pourraient envisager cette forme sociale, afin d’optimiser leur organisation sur l’ensemble du territoire européen. Dans l’attente de telles améliorations, une autre lueur d’espoir semble également apparaître au travers d’un projet de société privée européenne.
La société privée européenne, un nouvel espoir ?
L’idée d’offrir aux petites et moyennes entreprises (PME), une structure européenne dite « société privée européenne » (SPE) qui serait moins lourde et moins contraignante que la SE, a commencé à prendre forme.
La Commission a ainsi rédigé, le 25 juin 2008, une proposition de règlement ayant soulevé de vives oppositions, du fait notamment du faible rattachement de cette nouvelle SPE aux droits nationaux, ainsi qu’à la grande place laissée à la liberté contractuelle.
La Commission s’inscrit alors dans une logique novatrice, marquée par un fort libéralisme, illustrant une volonté de facilité de constitution de SPE. En effet, à la différence des actuelles structures européennes (SE, coopérative européenne, GEIE ou Groupement européen d’intérêt économique), la SPE ne nécessiterait pas un caractère transfrontalier : plus précisément, le projet de règlement n’impose aucunement aux associés d’être ressortissants ou résidents d’au moins deux États membres. Ainsi, la SPE pourrait être constituée ex nihilo par une ou plusieurs personnes physiques ou entités juridiques.
La SPE serait une société à responsabilité limitée avec un capital minimum d’un euro : aussi, une bonne partie des obstacles rencontrés lors de la constitution d’une SE semble supprimée. Ensuite, le projet laisse, comme il l’a été évoqué plus haut, une grande place à la liberté contractuelle, dans la mesure où la SPE serait régie par les dispositions du règlement, les statuts et, seulement à titre subsidiaire, en cas de silence des deux sources précédentes, par les lois nationales, sauf renvoi expresse du règlement. Malheureusement, les aspects de droit fiscal, de droit social, de droit des procédures collectives et de droit comptable devraient rester soumis à la compétence des États membres.
Enfin, et c’est sur ce point que nombre de débats se cristallisent, il a été proposé d’opérer une dissociation entre siège statutaire et siège réel : or, cela revient à consacrer le critère de l’incorporation, et ainsi d’offrir la possibilité pour une société de s’immatriculer dans le pays de son choix, et choisir corrélativement la loi qui lui serait applicable. Dès lors, le risque de forum shopping devient évident.
Le parlement européen, tout en approuvant le principe, le 10 mars 2009, de l’introduction d’une structure souple à l’usage des PME, a très largement amendé le projet, notamment afin d’éviter que la SPE ne soit utilisée « pour contourner les obligations légales légitimes imposées par les États membres », préconisant notamment la restriction de l’accès à la SPE aux entreprises présentant un caractère transfrontalier.
Un compromis a été élaboré. Celui-ci a toutefois été rejeté par le Conseil de l’Union européenne les 30 et 31 mai 2011, les principaux points de désaccords portant évidemment sur le siège de la SPE, l’absence de capital social minimum ainsi que la participation des travailleurs.
Ce blocage est tout à fait regrettable dans le contexte du Smal Business Act qui vise à favoriser l’activité des PME européennes au sein du Marché unique (Think small first). D’autant plus que les PME représentent une grande majorité des entreprises dans l’Union européenne et qu’un très petit nombre d’entre elles seulement se tourne vers des activités transfrontalières. Ce blocage semble ainsi mettre en exergue un véritable échec de la construction européenne.
La société européenne, véritable atout pratique, semble encore être au stade gestation, la complexité qu’elle présente dans l’imaginaire collectif des associés, entrepreneurs et investisseurs, ainsi que l’absence d’un statut fiscal adapté l’empêchant encore de prendre pleinement son envol. Peut-être que certaines modifications, ajoutées à la création éventuelle d’une « société privée européenne » permettront enfin à l’Union européenne d’avoir la société qu’elle mérite.
Roman Kaczynski
[1] Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne.
[2] Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs.
[3] Horst Eindenmüller and Jan Lasák, The Czech Societas Europea Puzzle.
[4] C. com., art. L. 229-6.
[5] C. com., art. L. 229-7.
[6] C. com., art. L. 229-11 à L. 229-15.
[7] C. com., art. L. 229-7, al. 6.
[8] Lettre de l’U.N.I.C.E du 27 août 2001 aux membres du Parlement européen.
[9] Y. Loussouarn, La proposition d’un statut des sociétés anonymes européennes et le droit international privé, Rev. crit. DIP 1971.
[10] Règlement (CE) n° 2157/2001, op. cit., art. 58.
[11] C. com., art. L. 229-11 à L. 229-15, op. cit.
[12] N. Lenoir, La Societas Europaea ou SE. Pour une citoyenneté européenne de l’entreprise, 19 mars 2007, p. 121 : Madame Noëlle Lenoir propose aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions simplifiées de se transformer en SE ou de participer à la constitution d’une SE par voie de fusion ou création d’une holding ou d’une filiale.
| POUR ALLER PLUS LOIN
C. Chabtini, Réflexions sur la société européenne : propositions d’amélioration et évolution de son statut, Petites affiches, 14 novembre 2007, n° 228, p. 4 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, Lexisnexis, coll. Manuel, 27e éd. 2014, 870 p. T. Schmitt, Les aspects fiscaux de la société européenne, Petites affiches, 16 avril 2002, n° 76, p. 29. M.-P. Souweine et J. Sibille, La société européenne : une incitation à réformer notre droit des sociétés ?, Petites affiches, 27 mai 2004, n° 106, p. 27. |
 Le petit juriste Site de la revue d'actualité juridique
Le petit juriste Site de la revue d'actualité juridique