A l’heure où la crise frappe nos économies de plein fouet, ne serait-il pas souhaitable de privilégier un certain protectionnisme local lors de la passation d’un marché public ? Cette possibilité, bien que préférable, est incontestablement exclue des procédures de passation afin de respecter les principes fondamentaux de la commande publique, notamment la non-discrimination et permettre ainsi le libre jeu de la concurrence.
L’article 1er du code des marchés publics (édition 2006) érige une concurrence effective en rappelant que « les marchés publics (…) respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ». Ces principes fondamentaux, véritables remparts dressés face aux risques de réservation de marché, de favoritisme ou d’élimination de certains opérateurs économiques, peuvent parfois vaciller, notamment lorsque l’attribution d’un marché public à l’offre économiquement la plus avantageuse permet de prendre en compte des critères écologiques.
Un arrêt rendu par la CJCE [1] est venu encadrer la référence et l’impact des clauses environnementales en tant que critère d’attribution d’un marché public. En effet, l’acheteur peut « prendre en considération des critères relatifs à la préservation de l’environnement pour autant que ces critères sont liés à l’objet du marché, ne confèrent pas audit pouvoir une liberté inconditionnée de choix, sont expressément mentionnés dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché et respectent tous les principes fondamentaux du droit communautaire, notamment le principe de non-discrimination ».
La prudence de cette démarche s’est également retrouvée dans l’article 6 du code des marchés publics relatif aux spécifications techniques contenues dans les documents de consultation des appels d’offre.

Ces spécifications techniques doivent permettre « l’égal accès des candidats et ne peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence » (art. 6-III). Ainsi, la référence à un écolabel au sein d’un appel d’offre a été permise, néanmoins, s’inscrivant dans la mouvance de l’affaire Concordia, les rédacteurs du code ont, à leur tour, souhaité limiter l’impact de la signalétique environnementale en permettant « la référence à tout ou partie d’un écolabel pour autant : 1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l’objet du marché ; 2° Que les mentions figurant dans l’écolabel aient été établies sur la base d’une information scientifique ; 3° Que l’écolabel ait fait l’objet d’une procédure d’adoption à laquelle ont participé des représentants des organismes gouvernementaux, des consommateurs, des fabricants, des distributeurs et des organisations de protection de l’environnement ; 4° Que l’écolabel soit accessible à toutes les parties intéressées » (art. 6-VII).
Un parallèle peut vite être opéré entre les quatre conditions de la CJCE et celles posées par le code pour la référence à un écolabel: les principes de non-discrimination et de libre concurrence représentent les clés de voûte de la commande publique.
Pour pallier cette difficulté, les pouvoirs adjudicateurs sont parfois tentés d’inclure dans les appels d’offre un certain localisme, déguisé sous la réduction des coûts de transports et de pollution. Cependant, aucune préférence locale ne peut être recherchée par les acheteurs, sous peine d’entrainer des pratiques discriminantes et de taxer cet outil de « protectionnisme vert ».
Clémence Pele
|
Notes [1] CJCE 17 septembre 2022, C-513/99, Concordia Bus Finland Oy AB |
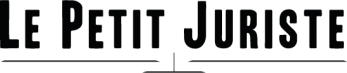 Le petit juriste Site de la revue d'actualité juridique
Le petit juriste Site de la revue d'actualité juridique





