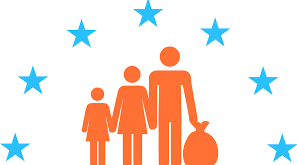Si le droit à la liberté d’expression est plus souvent revendiqué que le droit au silence, celui-ci n’en reste pas moins l’un des principaux volets des droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale. La possibilité de garder le silence et d’être informé d’un tel droit concerne plus particulièrement le régime de la garde à vue, lorsqu’une personne est amenée à répondre aux questions d’un officier de police dans le cadre d’une affaire où elle est suspectée.[1]
Cette stratégie peut s’avérer judicieuse : en effet, dans la plupart des cas d’erreurs judiciaires, depuis l’affaire Patrick Dils à celle d’Outreau, les accusés s’étaient exprimés pendant leur garde à vue.
Or, il existe une véritable inégalité dans le respect de ce droit selon les États. Depuis longtemps ancré dans les pays de tradition accusatoire, le droit de se taire a peiné à s’imposer au sein des systèmes inquisitoires comme le notre.
Aux États-Unis, tout remonte au célèbre arrêt Miranda contre Arizona.[2]
Les faits étaient les suivants : en 1962, un homme appelé Ernesto Miranda est soupçonné par la police de Phoenix d’avoir séquestré et violé plusieurs jeunes femmes. Il est alors arrêté et interrogé, sans avoir été informé de ses droits. Miranda avoue avoir commis les faits qui lui ont été reprochés, puis est condamné à la suite du procès enclenché contre lui. Toutefois, il interjette appel de sa condamnation sous prétexte que les aveux qui lui ont été extorqués sont irrecevables. L’affaire remonte jusqu’à la Cour Suprême, qui décide dans un arrêt devenu fondateur, que : «The person in custody must, prior to interrogation, be clearly informed that he has the right to remain silent, and that anything he says will be used against him in court ».[3] Pour la Cour Suprême, le fondement juridique de ce droit découle du 5e amendement de la Constitution, d’après lequel « no person shall be (…) compelled in any criminal case to be a witness against himself ».[4]
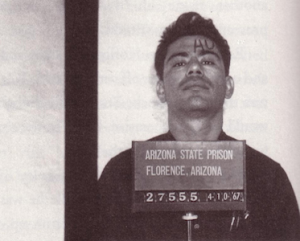
Il en va de même au Royaume-Uni, où le droit au silence est consacré à travers le concept de « privilege against self-incrimination » depuis 1942 déjà et l’affaire Blunt v. Park Lane Hotel. Ce « privilège » est décrit de la façon suivante : « …the rule is that no one is bound to answer any question if the answer thereto would, in the opinion of the judge, have a tendency to expose the deponent to any criminal charge, penalty or forfeiture which the judge regards as reasonably likely to be preferred or sued for ».[5]
Si le droit de se taire est aujourd’hui bien institué dans les pays de Common Law, c’est en raison de la tradition accusatoire de leur système procédural. Celui-ci se caractérise par son aspect contradictoire, public et oral, qui cantonne le juge à un simple rôle d’arbitrage entre l’accusation et la défense et où l’administration des preuves est à la charge des parties. L’égalité des armes occupe donc une place importance, aucune partie n’étant avantagée par rapport à l’autre. Il est ainsi essentiel que la défense dispose de droits étendus, notamment celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination en étant libre de garder le silence.
À l’inverse, la France, comme d’autres pays continentaux, a longtemps suivi une tradition inquisitoire du procès pénal. Dans ce système, le juge est doté d’un rôle bien plus actif, sa mission consistant à faire triompher la vérité et à défendre les intérêts de la société. L’enquête occupe une place prépondérante, dans le cadre d’une procédure écrite, secrète… et non contradictoire. Autrement dit, l’égalité des armes entre les parties n’est pas la préoccupation essentielle, puisqu’il s’agit avant tout de réunir des preuves devant permettre à la vérité d’éclater. Cette dernière doit idéalement revêtir la forme d’un aveu de la personne mise en cause.
C’est ce qu’on appelle la « religion de l’aveu », ou encore l’aveu comme « reine des preuves ».
Or, rappelons que le gardé à vue et son avocat, dans la version traditionnelle de ce système, ont un accès très limité au dossier à ce stade, et ne connaissent pas avec exactitude les faits en cause. Répondre à des questions sur une affaire dont on ignore tout, dans un fort état de tension psychologique, telle est la stratégie adoptée pour faire avancer l’enquête. Cela n’est pas sans rappeler l’usage de la torture sous l’inquisition pour récolter des informations ou obtenir des aveux. Forcément, la notification du droit au silence n’y a pas sa place, se taire étant perçu comme un moyen d’entraver l’action de police dans sa quête de vérité.
Dès lors, il n’est pas surprenant que ce droit, ou du moins sa notification au gardé à vue ait connu une évolution chaotique avant de s’imposer dans la législation française.
Celui-ci fait son entrée dans notre législation avec la loi n° 2000-516,[6] à travers un nouvel article 63-1 du Code de procédure pénale, qui prévoyait la notification au gardé à vue de son droit de se taire. Celui-ci connaît toutefois une bien courte carrière puisque la loi n° 2003-239[7] met un terme sa notification formelle, ce droit continuant à exister sans que le gardé à vue en soit informé.
Inutile de souligner à quel point il est périlleux de se prévaloir d’un droit dont on ne connaît pas l’existence.
C’est grâce à l’impulsion de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme que la notification du droit au silence est réapparue dans la procédure pénale française.
En effet, bien qu’il ne figure pas explicitement dans la Convention, le droit au silence découle des principes du procès équitable définis à l’article 6 § 1 dont l’importance a été réaffirmée à travers de nombreux arrêts, dont le célèbre John Murray c/ Royaume-Uni rendu le 8 février 1996.
En France, l’évolution est lente à s’imposer. Si le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 30 juillet 2010, jugeait déjà que l’absence de notification du droit de se taire était contraire à la Constitution, il a fallu attendre une fois de plus une intervention européenne : c’est la condamnation de la France dans l’arrêt Brusco c/ France, rendu par la CEDH le 14 octobre 2010, qui a précipité la réforme de la garde à vue vers un idéal plus respectueux des droits de la défense.
Suite à cet arrêt, le législateur a été contraint de mettre le droit français en conformité avec les exigences de Strasbourg, à travers la nouvelle loi n° 2011-392.[8] Depuis, le nouvel article 63-1 du Code de procédure pénale mentionne bien, et sans doute définitivement cette fois, la notification au gardé à vue de se taire après avoir décliné son identité.
Ce passage d’une tradition inquisitoire à un système hybride n’est pas le seul apanage de la procédure pénale française, mais bien une tendance qui touche la plupart des pays de droits continentaux. Récemment, l’État monégasque s’est fait condamné par la CEDH pour violation de l’article 6 § 1, dans l’arrêt Navone et a. c/ Monaco,[9] car les gardés à vue n’avaient pas été informés de leur droit de garder le silence, quand bien même ils avaient renoncé à être assisté par un avocat.
On peut donc constater qu’il s’agit d’une tendance générale vers une plus grande prise en compte des droits de la défense, de façon effective et concrète. Cela va même jusqu’à dépasser le seul cadre de la garde à vue, pour s’étendre à toute situation à potentiel coercitif. La récente loi n° 2014-535,[10] par exemple, entrée en vigueur le 2 juin 2014, refonde le régime de l’audition libre de sorte que désormais, toute personne suspecte doit être informée de ses droits, dont celui de se taire et de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie, avant de pouvoir être auditionnée.
Suzanne Azmayesh
[1] C. pr. pén., art. 62-2 : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. »
[2] Cour Suprême des États-Unis, 13 juin 1966, 384 US 436 : https://en.wikisource.org/wiki/Miranda_v._Arizona
[3] La personne en garde à vue doit, avant son interrogatoire, être clairement informée de son droit à garder le silence, et que tout ce qu’elle dira pourra être utilisé contre elle devant les tribunaux
[4] Nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même dans une affaire criminelle.
[5] Nul ne peut être contraint de répondre à une question si celle-ci, d’après le juge, peut avoir pour conséquence d’exposer à des poursuites pénales.
[6] Loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et le droit des victimes.
[7] Loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure.
[8] Loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.
[9] CEDH, 24 octobre 2013.
[10] Loi du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement euroéen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
 Le petit juriste Site de la revue d'actualité juridique
Le petit juriste Site de la revue d'actualité juridique